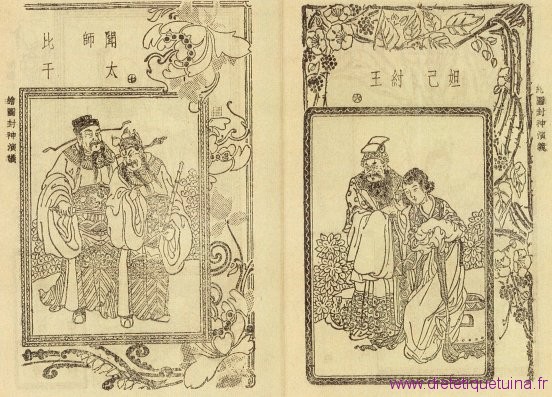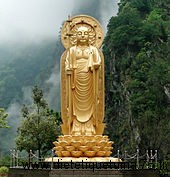La femme-renarde
La femme-renarde (chinois : 狐狸精 ; pinyin : húlíjīng ; Wade : hu²li²ching¹ ; EFEO : houliking ; cantonais Jyutping : wu⁴lei⁴zing¹) est un personnage chinois récurrent des contes de Pu Songling, intitulés Liáozhāi… Lire la suite »La femme-renarde